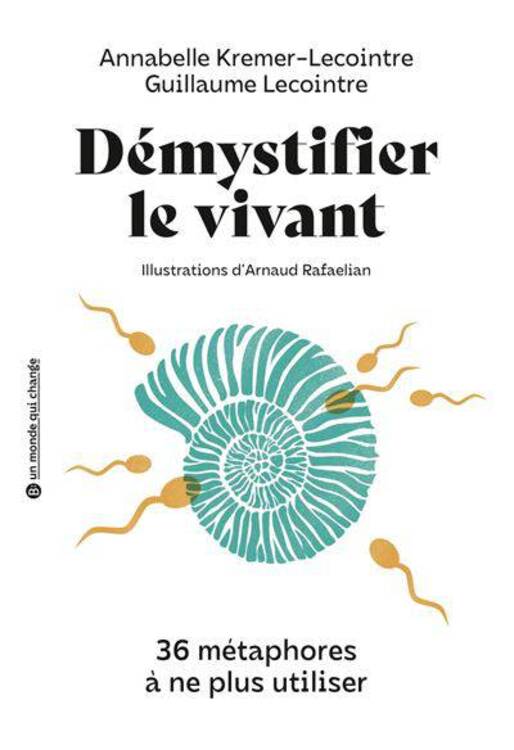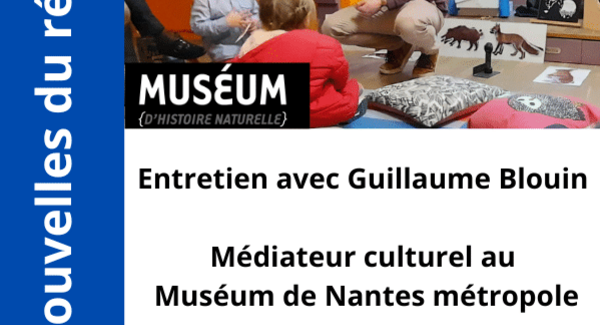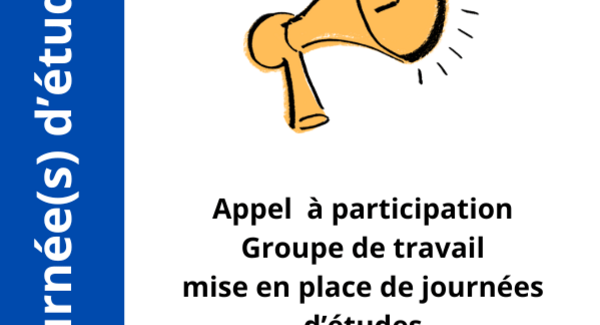[ Les lectures du réseau ] - Démystifier le vivant - Annabelle Kremer-Lecointre et Guillaume Lecointre
Publié par TACTISS, le 31 mars 2025 18
Annabelle Kremer-Lecointre, Guillaume Lecointre, Démystifier le vivant, 36 métaphores à ne plus utiliser, Belin éducation/Humensis, 2023
Note de lecture rédigée par Xavier Noël, président de TACTISS
Pour agir face à un certain nombre de défis environnementaux, sanitaires et scientifiques, un préalable consiste à comprendre le monde vivant dans sa complexité. Telle est l’intention de cet ouvrage écrit par deux scientifiques qui se sont appuyés sur leur expertise épistémologique et didactique pour déconstruire 36 métaphores et expressions courantes qui véhiculent des conceptions erronées du vivant.
En voici un exemple simple (d’autres cas décrits dans l’ouvrage étant plus complexes). Depuis quelques années, nombre de publications évoquent « l’intelligence des plantes ». Or si celles-ci « ne sont ni passives, ni immobiles, ni dénuées de perception sensorielle », on ne peut pas les qualifier d’intelligentes, bien qu’étant en capacité de percevoir un certain nombre de stimuli, comme la lumière, l’alternance entre le chaud et le froid, le champ gravitationnel, le vent, l’humidité, les gradients chimiques du sol, la pression atmosphérique, les vibrations…, quand bien même aussi elles émettent des composés organiques et des métabolites pouvant être échangés avec d’autres êtres vivants. C’est pourquoi des biologistes et d’autres scientifiques ont appelé en particulier les partisans de la neurobiologie végétale à ne pas faire usage de termes inappropriés, emprunts d’anthropomorphisme, ou d’anthropocentrisme. Deux notions, comme le précise le remarquable glossaire en fin d’ouvrage, consistant à soit à mettre l’humain au centre de tout (anthropocentrisme) soit à projeter des propriétés humaines sur une entité non humaine (anthropomorphisme). On peut concevoir que la métaphore puisse avoir pour but de rendre les plantes plus proches de nous, voire d’éveiller notre conscience écologique, mais l’inconvénient est qu’elle ne permet pas de véritablement comprendre les plantes et n’améliore pas l’état des connaissances en physiologie et biologie cellulaire végétales.
Se pose alors la question suivante : par quoi remplacer des métaphores comme « Les forêts, poumons verts de la planète », « La nature est bien faite », « La stratégie adaptative », « Le fossile vivant », « Les globules blancs en guerre pour défendre l’organisme » ? La réponse n’est pas toujours aisée… En médiation scientifique y aurait-il alors à se méfier des explications imagées, quand elles sont de nature à être simplificatrices à outrance, voire à induire des biais de compréhension ? De nouveau, le glossaire apportera quelques précieux garde-fous aux médiatrices et médiateurs qui pourraient s’interroger face aux constats du livre et son appel à la prudence. Ainsi, gardons-nous de tout idéalisme, auquel on peut opposer « le réalisme selon lequel le monde extérieur à nous existe indépendamment de nous : l’existence du monde réel précède l’existence de nos idées, et continue sans elles » ; méfions-nous du biais d’intentionnalité qui consiste à voir des comportements humains ou des intentions là où il n’y en a pas, ou encore du réductionnisme, face à un monde réel qui est d’une grande complexité, constitué d’un « entrelacs de chaines de causes à effets », appréhendables selon des temps divers (de quelques secondes à des milliards d’années) et à des échelles très variées.
Si les métaphores et expressions retenues ici concernent les écosystèmes, la biodiversité, l’évolution du vivant, l’espèce humaine, les gènes et le fonctionnement de l’organisme, bien entendu d’autres domaines scientifiques sont concernés par cette réflexion. L’Académie littéraire de Bretagne et des Pays de la Loire avait retenu cet ouvrage dans la sélection de sa première édition du Prix du livre sciences et société. Le sujet de l’usage de la métaphore en médiation scientifique constitue un champ plein de richesse, à investiguer aussi bien du point de vue littéraire que scientifique.
Xavier Noël
Vous aussi vous souhaiter partager une de vos lectures ? C'est par ici :
Appel à participation - les lectures du réseau | ECHOSCIENCES - Nantes Métropole